Les inégalités fiscales
Dans un monde où la fiscalité se révèle être un miroir des inégalités sociales, cet article explore les subtilités et les contradictions du principe d'égalité fiscale, fondement de la justice sociale et de la démocratie moderne. S'appuyant sur des références historiques, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des décisions récentes du Conseil constitutionnel, il questionne la capacité de nos systèmes à garantir une égalité véritable face à l'impôt. À travers une analyse rigoureuse, découvrez comment les principes d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques, bien que consacrés constitutionnellement, se heurtent aux réalités des dispositifs fiscaux. Entre avantages réservés à certains contribuables, pratiques d'évasion fiscale, et mécanismes complexes, les inégalités se creusent, avec des conséquences économiques, sociales, et politiques majeures.
FISCALITÉFRAUDE
Fabio Zagaroli
11/16/202412 min read
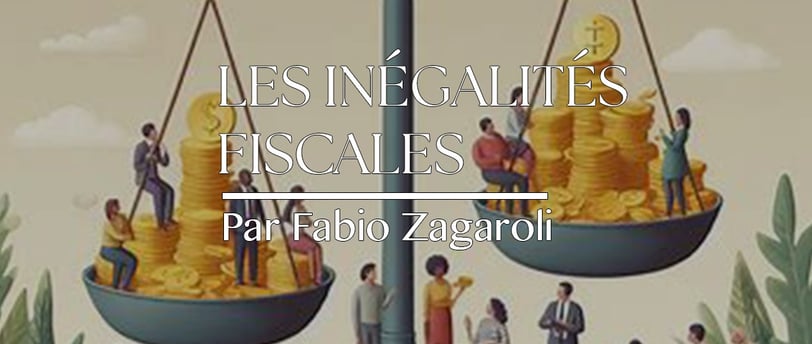
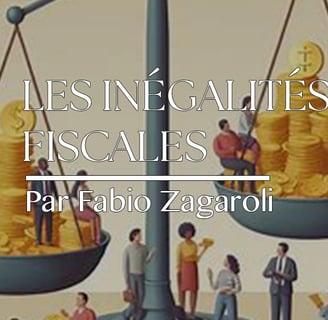
Benjamin Constant, homme politique et écrivain avait exprimé que : “L'excès des impôts conduit à la subversion de la justice, à la détérioration de la morale, à la destruction de la liberté individuelle.” Cette citation met en exergue un caractère de justice fiscal, et d’une nécessité d’égalité devant l’impôt.
Les inégalités fiscales peuvent se définir de manière négative comme ce qui n’est pas égal. Il convient donc de définir l’égalité fiscale. Cette dernière désigne un principe fondamental en matière de fiscalité, qui repose sur l'idée que tous les citoyens doivent être traités de manière égale devant l'impôt, en fonction de leur capacité contributive. Il peut exister deux formes d’égalité fiscale.
L'égalité formelle signifie que toutes les personnes se trouvant dans une même situation doivent être soumises aux mêmes règles fiscales. Cela implique que les contribuables ayant un même niveau de revenu ou de richesse doivent payer des impôts identiques, sans favoritisme ni discrimination. Ce principe découle de la notion d'égalité devant la loi, qui est souvent inscrite dans les Constitutions nationales.
Toutefois, l'égalité réelle, quant à elle, prend en compte la capacité contributive des contribuables, c’est-à-dire leur aptitude à supporter la charge fiscale en fonction de leurs revenus, de leur patrimoine et de leur situation personnelle. Ce principe se matérialise généralement par une progressivité de l'impôt. En somme, l'égalité fiscale vise à équilibrer ces deux notions : traiter les contribuables de manière égale tout en tenant compte de leurs différences de capacités contributives pour instaurer une justice fiscale.
Le principe d’égalité est un principe fragile du fait que le moindre mécanisme peut engendrer des inégalités. L’intérêt du sujet revient donc à déterminer les grands principes de l’égalité fiscale ainsi que leurs sources puis d’observer les mécanismes pouvant porter atteinte à cette égalité et faire des prévisions pour les années à venir si certaines inégalités fiscales vont persister ou si l’on va se rapprocher vers une égalité à ce niveau.
Ainsi, le principe à valeur constitutionnel d’égalité devant l’impôt est-il respecté ou au contraire, divers dispositifs fiscaux créent-ils une inégalité de traitement entre contribuables ?
L’égalité fiscale est consacrée par le Conseil Constitutionnel sur deux fondements, l’égalité devant l’impôt et l’égalité devant les charges publiques (I.). Cependant, en pratique, il existe des mécanismes créant des inégalités qui ont un impact fort sur la société, même si les perspectives d’avenir semblent encourageantes à cet égard (II.)
I. Un principe d’égalité fiscale à valeur constitutionnelle reposant sur deux fondements textuels
Le principe d’égalité devant l’impôt est issu de deux articles différents de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) qui seront confirmé par le Conseil Constitutionnel au XXème siècle, l’égalité devant l’impôt issue de l’article 6 de la DDHC (A.) et de l’égalité des charges publiques issue de l’article 13 de la DDHC (B.)
A. L’égalité devant l’impôt issue de l’article 6 de la DDHC
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est entrée dans l’ordre juridique grâce à la décision liberté d’association de 1971 rendue par le Conseil Constitutionnel. Elle est depuis lors dans le bloc constitutionnel, c’est-à-dire que les dispositions de la DDHC sont supérieures aux lois, y compris la loi fiscale.
L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que la loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L’article 6 de la DDHC consacre donc l’égalité des citoyens devant la loi.
Cependant, le principe de légalité de l’impôt, visant à garantir l’application du consentement à l’impôt, prévu à l’article 14 de la DDHC permet de faire le lien entre la loi fiscale et le principe d’égalité. Effectivement, si l’impôt provient de la loi et que les citoyens disposent d’un principe d’égalité devant cette loi. Alors, il découle un principe d’égalité des citoyens devant l’impôt.
Le Conseil Constitutionnel, garant de la Constitution ainsi que des principes en découlant et veillant à ce que la loi se conforme à ces dispositions, a consacré ce principe d’égalité devant l’impôt issu de l’article 6 de la DDHC avec la décision « Taxation d’office » rendue le 27 décembre 1973. La décision était à propos de l’article 62 de loi de finance pour 1974. La décision dispose que l’article « tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 ».
Cependant l’égalité devant l’impôt signifie que les contribuables placés dans une situation semblable doivent être traités fiscalement de manière identique. Une différence de traitement peut donc intervenir dans le cas où des citoyens appartiendraient à des catégories différentes. En somme, le principe d’égalité devant l’impôt s’applique à tous les citoyens se trouvant dans des catégories similaires qui sont mises en place par le législateur conformément à l’article 34 de la Constitution qui délimite sa compétence.
De ce principe, il est donc possible que des inégalités soient possibles. En effet, s’il est impossible d’effectuer une différence de traitement entre les citoyens se trouvant dans des situations similaires. Il est envisageable de mettre en place une différence de traitement entre les catégories. Ceci est accepté par le Conseil Constitutionnel, comme lors de la décision question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 27 janvier 2023 où il avait déclaré conforme à la Constitution la différence de traitement fondé sur la différence de situation.
Le Conseil Constitutionnel avait également déclaré non conforme à la Constitution la loi visant à lutter contre la pollution instaurant des exonerations de taxe au profit d’entreprise ayant une activité polluante dans la décision du 28 mai 2020 en déclarant que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi ». On voit ici qu’il était paradoxal qu’une entreprise polluante soit exonérée de taxe alors que l’objet de la loi était de lutter contre la pollution.
On remarque donc un autre élément permettant d’effectuer une distinction de traitement pour des citoyens se trouvant dans une situation similaire, c’est lorsque l’intérêt général le requiert. Et il est également ajouté que dans le cas où les citoyens appartiennent à des catégories différentes ou dans le cas où l’intérêt général le requiert, il est nécessaire que les mesures soient prises en accord avec l’objet de la loi.
En somme l’article 6 de la DDHC qui consacre l’égalité devant la loi permet de déduire une égalité devant l’impôt permet tout de même de traiter différemment des citoyens s’ils appartiennent à des catégories différentes ou lorsque l’intérêt général le requiert, lorsque la différence de traitement est conforme à l’objet de la loi. Cependant, un autre article de la DDHC permet d’établir l’égalité fiscale, l’article 13.
B. L’égalité devant les charges publiques issue de l’article 13 de la DDHC
L’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacre quant à lui l’égalité devant les charges publiques. Il dispose que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
L’égalité devant les charges publiques impose donc que l'impôt ne peut pas se revêtir d’un caractère confiscatoire ou faisant peser sur une catégorie de contribuable, des charges excessives au regard de leurs facultés contributives. Cela peut être, par exemple, lorsque le contribuable est imposé sur des sommes qu’il ne possède pas, le Conseil Constitutionnel l’a confirmé lors de la décision QPC du 25 juin 2021.
Il revient donc à ceux qui mettent en place les règles fiscales, soit le législateur de déterminer des règles ne créant pas un déséquilibre entre les différentes catégories de contribuables en leur faisant porter une charge trop lourde par rapport à ce qu’ils peuvent contribuer. Les règles doivent donc s’appuyer sur des critères sociaux les plus objectifs possible et en fonction du but qu’il souhaite atteindre comme vu précédemment, afin de ne pas léser une catégorie.
Dans le cas d’une réglementation trop inégalitaire, une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques pourrait être décidée. C’est le cas d’un impôt sur la fortune, s’ajoutant à d’autres impositions et sans dispositif de plafonnement que le Conseil Constitutionnel a tranché lors de la décision du 9 août 2012 qu’il était susceptible de constituer un impôt confiscatoire créant ainsi une rupture d’égalité devant les charges publiques envers la catégorie à laquelle s’appliquait cet impôt. Au contraire, le Conseil Constitutionnel a décidé qu’une tranche d’imposition de 45% dans le cadre de l’impôt sur le revenu ne revêt pas d’un caractère confiscatoire.
Une autre application du principe d’égalité devant les charges publiques peut être constatée lors de la décision du 29 décembre 2009 rendue par le Conseil Constitutionnel à propos de la loi de finance pour 2010. En l’espèce, la loi contenait des dispositions pour la contribution carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Cependant, un problème résidait sur la catégorie à laquelle la loi faisait peser la charge de l’impôt puisque cette loi la faisait peser sur les personnes les moins responsables d’émission de gaz à effet de serre. Ce qui caractérise un caractère confiscatoire et une rupture d’égalité devant les charges publiques.
En somme, le principe d’égalité fiscale apportée par l’article 13 de la DDHC permet d’empêcher le législateur de mettre en place des impôts à caractère confiscatoire ou de faire peser sur une catégorie de contribuable une charge trop élevée par rapport à leurs capacités contributives. Cependant, il existe quand même des mécanismes permettant à certains contribuables d’obtenir des avantages fiscaux, créant des inégalités entre contribuables d’une même catégorie et qui a un impact fort sur la société.
II. Des mécanismes fiscaux à fortes conséquences créant des inégalités entre contribuables
Il existe des mécanismes légaux ou illégaux permettant à un contribuable d’être avantagé par rapport à un contribuable d’une même catégorie (A.) et ces mécanismes ont des conséquences lourdes pour la société dans son ensemble (B.)
A. Les mécanismes fiscaux générant des inégalités entre contribuables
Dans les mécanismes fiscaux permettant à un contribuable de tirer un avantage fiscal par rapport à un autre contribuable d’une même catégorie qui ne s’en prévaut pas, il y a une distinction importante à faire.
Dans un premier temps, il y a les mécanismes légaux, mis en place par le législateur. Dans ceux-ci, on peut retrouver les crédits et réductions d’impôt, les exonérations. D’autre part, on retrouve des schémas complexes mis en place par des personnes morales ou privées permettant de baisser le montant de l’impôt à payer. Si ces mécanismes sont légaux, c’est que le législateur a volontairement laissé ces portes ouvertes et d’en faire bénéficier des contribuables.
En général, le législateur utilise l’impôt au sens large comme outil d’incitation. C’est à dire qu’il va essayer de modifier le comportement des contribuables en lui donnant des avantages ou des charges fiscales en fonction du comportement qu’il veut développer et en fonction des enjeux qu’il poursuit. Par exemple, le législateur peut mettre en place des dispositifs fiscaux qui alourdissent la charge d’une personne qui pollue. C’est le principe du pollueur-payeur. Pour illustrer, le Conseil Constitutionnel a décidé le 11 octobre 2019 dans la QPC Société Total raffinage France que l'exclusion de l'huile de palme du régime favorable de la taxe sur les biocarburants ne viole pas le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté garantis par la Constitution. L'appréciation du législateur est jugée conforme à l'objectif de protection de l'environnement, et le critère retenu est adéquat au regard des connaissances actuelles sur les impacts environnementaux de cette production. Le refus d’exonérer constitue en soi une inégalité car entre les producteurs il y en a un qui aura une charge supplémentaire par rapport à l’autre, cependant comme vu précédemment, l’intérêt général et dans le cas échéant la préservation de l’environnement permet la mise en place de cette égalité.
En dehors des règles simples comme l'exonération ou la réduction ou augmentation d’impôt qui est mise en place par le législateur, il y a des mécanismes légaux qui peuvent être mis en place par le contribuable lui-même. C’est le cas des mécanismes d’endettement, de démembrements de propriétés, de restructurations de sociétés ou encore le système de holding. C’est le contribuable ici qui est libre d’utiliser ces mécanismes pour son propre intérêt. Mais cela peut constituer une inégalité dans le sens où deux contribuables d’une même catégorie au sens de l’article 13 de la DDHC ne seraient pas soumis à la même charge d'impôts.
De l’autre côté, il y a des mécanismes illégaux, qui ne sont pas prévus par le législateur ou bien qui sont sanctionnés par celui ci, on peut imaginer ici l’évasion fiscale dans laquelle le contribuable ne vont pas déclarer l’ensemble de leurs revenus de manière délibérée de manière à payer moins d’impôt ou de transférer ces revenus dans un autre pays ou région ayant une fiscalité plus faible. Ces Etats, qui sont qualifiés de paradis fiscaux, créent une inégalité fiscale à niveau international lorsque certains contribuables de pays étrangers ou ayant une double nationalité en profitent au détriment du premier Etat.
Ces mécanismes fiscaux qui mettent en place légalement ou non des inégalités ne sont pas vides de conséquences pour la société.
B. Des conséquences lourdes pour la société générées par les inégalités fiscales
Les inégalités fiscales, qu’elles soient légales ou non, ont des impacts énormes sur la société dans son ensemble car elle touche à tous les piliers indispensables de la société.
Premièrement, il va y avoir des conséquences économiques. Effectivement, les inégalités fiscales amplifient les écarts de revenu et de patrimoine, car les dispositifs fiscaux avantageux profitent principalement aux plus riches. Les foyers à revenus modestes, plus lourdement taxés, voient leur pouvoir d'achat et leur consommation diminuer, ce qui peut freiner la croissance économique du pays. Par ailleurs, les recettes fiscales insuffisantes réduisent l'efficacité des dépenses publiques, limitant les investissements dans des secteurs clés, ce qui peut entraver le développement économique à long terme.
Dans un second temps, sur le plan social, les inégalités fiscales créent un fort sentiment d'injustice, créant des tensions entre les différentes classes sociales. L'accès inégal aux services publics, notamment pour les populations modestes, accentue les disparités et limite la mobilité sociale. Cette situation engendre également la stigmatisation des bénéficiaires d'aides sociales, renforçant les divisions au sein de la société et affaiblissant la cohésion sociale
Pour l’aspect politique, les inégalités fiscales érodent la confiance des citoyens envers les institutions publiques et l’État, alimentant la défiance et le cynisme. Cette situation peut mener à une instabilité politique, avec l'émergence de mouvements sociaux et politiques contestant les inégalités. De plus, un système fiscal perçu comme injuste affaiblit la solidarité nationale, renforçant la polarisation politique et les tensions entre groupes d'intérêts divergents, parfois au profit de discours populistes.
Enfin, sur le plan international, les inégalités fiscales exacerbent la concurrence fiscale entre pays, affaiblissant les capacités des États à générer des recettes fiscales suffisantes pour financer leurs services publics. Les pays en développement, en particulier, sont affectés par l’évasion fiscale et la concurrence internationale, ce qui les empêche de lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités. Ces dynamiques accentuent les inégalités entre pays riches et pauvres, ainsi qu’au sein des pays eux-mêmes.
La perspective d’avenir à propos des inégalités fiscales est prometteuse et issue d’une combinaison entre réformes nationales et internationales. La progressivité de l’impôt est revue en modifiant les barèmes et souhaitant atténuer les inégalités entre contribuables. Il y a également une réduction des niches fiscales et une optimisation de la dépense publique. L’harmonisation internationale insufflée par l’Union Européenne et l’OCDE vise à réduire la concurrence fiscale et lutter contre l’évasion fiscale.
