L’Europe c’est la paix ?
« L’Europe, c’est la paix ». Ce slogan, notamment invoqué à Maastricht en 1992, est aux lèvres de chaque défenseur de l’Union. Il est jeté à la figure de chaque contestataire du nouvel ordre européen comme une justification à tous les maux qu’il provoque, mais également comme une accusation envers ses opposants. Puisque l’Europe est la paix, ses détracteurs ne peuvent être que de viles personnes aux idées résolument bellicistes. Aujourd’hui, ce slogan suscite le sourire, et pour cause, ce dernier est totalement dénué de profondeur. Il est en effet chose aisée d’annihiler le semblant d’esprit qui compose cette devise. Il convient donc dans cet article de montrer que l’Europe n’est pas la paix et qu’au contraire, elle est sans doute davantage la guerre.
POLITIQUEUNION EUROPÉENNE
Alexandre Horace
11/20/20247 min read
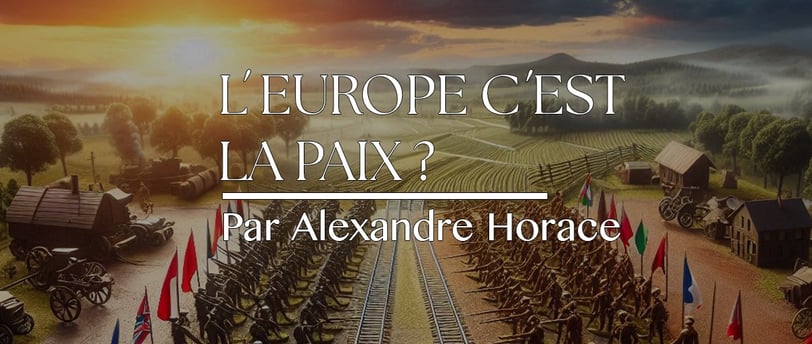
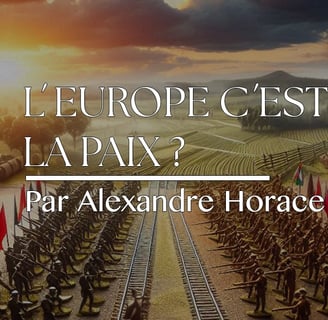
Le 9 mai 1950, Robert Schuman alors ministre français des affaires étrangères déclare : « L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre ». Cette affirmation est déjà bien malhonnête. Monsieur Schuman aurait en effet tout aussi bien pu dire : « Le projet anarchiste n’a pas été fait, nous avons eu la guerre » ou bien encore : « L’hégémonie française n’a pas été faite, nous avons eu la guerre ». Par ces mots, tout ce qui n’a pas été fait antérieurement peut être invoqué comme la solution à un problème plurimillénaire des sociétés humaines que sont les confrontations armées. C’est pourtant sur cette idée que se base en grande partie l’Union européenne comme nous pouvons le constater dans l’article 3 du Traité de Lisbonne – qui rappelons le, fut ratifier au mépris de la volonté populaire exprimée lors du référendum de 2005 – qui suppose que la paix fait partie des objectifs que l’Union doit promouvoir. Par ailleurs, les instances de l’Union se plaisent à mettre en avant l’obtention d’un prix Nobel de la paix obtenue en 2012 pour « avoir fait avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe ». Nous allons donc nous pencher avec objectivité sur ce que cache cette belle façade.
De la guerre sur le Vieux Continent :
L’Europe a connu au cours de l’Histoire des conflits meurtriers emportant dans la tombe des millions d’hommes, de femmes et d’enfant. Tous ces épisodes d’affrontements entre nations européennes ont trouvé leur apogée lors des deux guerres mondiales responsable d’environ 10 millions de morts pour la première et entre 40 à 60 millions pour la seconde. L’Union européenne se dit donc être la vaillante protectrice de la paix recouvrant le continent européen depuis 1945. Une paix brutalement brisée par l’ignoble dictateur, Vladimir Poutine, qui, sans vergogne, aurait décidé d’attaquer sans justification l’occident tout entier à travers l’Ukraine. Pourtant, la guerre russo-ukrainienne n’est pas le seul conflit qu’a connu le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, il existe un certain nombre de conflits non-armés provoquant de réelles tentions comme Chypre, pays membre de l’Union qui n’a le contrôle que de la moitié de son territoire, l’autre partie étant contrôlé par un Etat fantoche de la Turquie. Également, l’agression du territoire maritime grec par la Turquie qui n’a suscité aucune réaction concrète de la part de l’Union. Seule la France fut en mesure de venir en aide à son allié. Ces deux exemples à eux seuls suffisent à démontrer la fébrilité des instances européennes en matière de protection de ses pays membres. En matière de conflit armé, il y a le conflit de 1991 engendré par la désintégration de la Yougoslavie qui semble avoir été savamment glissé sous le tapis. Il est, en effet, étrange que la mort d’environ 150 000 personnes soit miraculeusement omise des discours européistes, à croire que les Balkans sont des terres de violences habités par des barbares naturellement brutaux. Il y aurait-il, selon l’UE, des européens de seconde zone ? Toujours est-il que ce conflit est un symbole, celui de l’inutilité de l’Union européenne. En effet, cette dernière n’a pas su proposer un plan de paix pour ce conflit, totalement éclipsé par les États-Unis, elle s’est vue alors réduite au rang de supplétif et de variable d’ajustement financier. Il n’y a qu’un pas pour dire que l’histoire se répète en Ukraine. Oui, l’Europe a capitulé, capitule et capitulera toujours devant les intérêts états-uniens au mépris de la paix qu’elle s’était juré de défendre.
Nous avons donc vu que la Pax Europa, si tant est qu’elle fut existante, a au moins durée de la période suivant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la guerre de Yougoslavie de 1991, soit 46 ans. Mais cette paix, est-elle l’œuvre des instances européennes ?
Quarante-six ans de paix en Europe :
D’abord, il faut pointer du doigt l’évidence : aucune institution européenne n’existait au début de cette ère de paix, par conséquent, elles ne peuvent évidemment pas en être les entières responsables. Selon l’historien Olivier Delorme, « l'Union européenne est une construction de guerre froide et non de paix. Elle émane de la volonté des Américains d'unifier un marché afin de favoriser la pénétration de ses produits ». Il ajoute que « La première cause de la paix en Europe, c’est l’écrasement de l’Allemagne en 1945 ». Il faut ajouter l’épuisement matériel des puissances européennes après la Seconde Guerre mondiale, mais la raison la plus évidente est sans doute la dissuasion nucléaire. Coincé entre les deux plus grandes puissances nucléaires de l’époque, les Etats-Unis et l’Union Soviétique, il est évident que la guerre devient impossible pour les pays européens, l’équilibre de la terreur fait son œuvre. De plus les pays d’Europe occidentale sont alors pour la plupart membre de l’OTAN et donc soumis aux américains, idem pour les pays d’Europe orientale avec l’Union Soviétique, or, on ne se fait pas la guerre entre laquais. Ce sont sans doute également les trente glorieuses qui ont fait bénéficier aux nations développées d’un contexte économique favorable et donc dissuadant du conflit. Ajoutons à cela que la paix européenne est aussi et surtout la résultante de volonté profondément nationale. Nous pouvons citer en exemple le rapprochement franco-allemand qui n’est en aucun cas le résultat de volonté d’instances européennes et qui bien qu’intéressé par des intérêts purement nationaux a au moins le mérite de maintenir de bonnes relations entre les deux nations éternellement rivales.
Un autre argument avancé par les européistes est de prendre le problème à l’envers en accusant le nationalisme d’être responsable des conflits armés en Europe en invoquant notamment encore une fois les deux guerres mondiales. Rien de plus fallacieux. Ce n’est en effet pas des nations qui ont provoqué la Première Guerre mondiale, mais des empires qui avaient besoin d’une expansion territoriale pour asseoir leur hégémonie. C’est l’impérialisme austro-hongrois créant une volonté d’asseoir sa domination sur les Balkans, qui a provoqué une réaction nationaliste serbe légitime au risque de colonisation de leur pays, réaction qui entraîna par le jeu des alliance les puissances européennes dans une guerre à échelle mondialisée. La Seconde Guerre mondiale, quant à elle, résulte davantage des idéologies donnant à certaines nations comme l’Allemagne un prétendu destin de domination totale de l’Europe. Là aussi, l’impérialisme est la cause majeure de ces conflits.
Les 46 ans de paix qu’a connus l’Europe n’est donc en aucun cas l’œuvres d’institution européennes. Si l’Europe n’est donc pas la paix, nous allons voir qu’elle est peut-être bien davantage la guerre.
L’Europe, c’est la violence :
L’Union européenne, nous le savons, est avant tout un espace de libre-échange. Ce n’est pas la coopération qui régit les relations économiques entre les Etats membres, mais la concurrence libre et non faussée. Cela fragilise les économies de certains pays et les empêche de mettre en place des mesures de protection de leurs productions et de leurs travailleurs. Si l’Union européenne empêche pour l’instant l’éclatement de conflit armé, elle conduit intrinsèquement à une montée des tensions. En effet, ce n’est pas parce qu’aucun soldat n’est mobilisé, qu’aucun obus n’est tiré que l’UE n’est pas génératrice de violences. Les politiques d’austérité imposées aux pays européens, par exemple, sont à l’origine d’une baisse drastique de qualité de vie pour tous leurs citoyens. Elle suppose des coupes budgétaires importantes dans les dépenses de l’Etat, aboutissant donc à la baisse de qualité des services publics. Inspiré de l’idéologie allemande, l’austérité est une politique injuste qui doit être supportée par l’ensemble des populations. Pourtant, les plus riches sont, selon l’INSEE, le seul groupe social à s’être enrichie depuis la période d’inflation aux dépens de tous les autres groupes. Il s’agit également du groupe ayant le plus bénéficié de soutien public et de baisses d’impôt. Corriger ces injustices sociales pour remettre à flot l’économie ne semble pourtant pas être à l’ordre du jour. Au lieu de ça, la Commission européenne et le Parlement européen ont décidé le 2 février 2024 de confirmer les critères d’austérité. Concrètement, cela signifie que les états membres n’auront pas le droit de dépasser un déficit de 3% du PIB et d’avoir une dette publique supérieure à 60% de la richesse nationale. Comprimer ainsi la dépense publique empêche la mise en œuvre d’une véritable politique de relance en injectant massivement de l’argent publique dans l’économie comme le font les États-Unis par exemple. En 2023, le résultat est sans appel, si le déficit américain est bien supérieur à celui de la zone euro, la croissance américaine est de 2,5% contre 0,5% pour la zone euro. La stratégie européenne est contre-productive et aggrave les crises existantes comme nous avons pu déjà le voir avec les pays du sud de l’Europe après la crise de 2008. L’Espagne, l’Italie, le Portugal ou encore, la Grèce, ont grandement souffert des politiques européennes et ont connu des catastrophes sociales aux conséquences terribles sur les populations. L’Union a déjà fait l’expérience de l’austérité, elle a déjà constaté son inefficacité en la qualifiant d’ « erreur » à de multiples reprises, pourtant, elle récidive. Ces politiques de paupérisation des populations et de réduction des services publics ne peuvent qu’aboutir à une montée des tensions.
Pourquoi donc empêcher la mise en place de politique de relance économique nationale ? Parce qu’abdiquer serait un aveu sur la réelle utilité de l’UE ? Sans doute. Toujours est-il que toutes ces observations que nous avons portées sont nécessaires à la distinction primordiale du remède, du parasite. C’est en transgressant une à une toutes les formules gravées dans le marbre de nos esprits que nous pourrons porter un jugement objectif sur la réalité des situations politiques et géopolitiques en nous questionnant par exemple sur l’utilité de certaines institutions : si l’Union européenne n’est pas la paix, à quoi nous sert-elle ?
